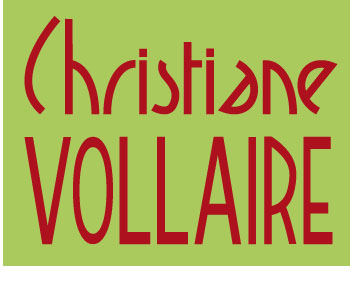Russell Banks dans le creuset de la Jamaïque
Pour les Cahiers critiques de Philosophie n° 19, Sur les Caraïbes
Décembre 2017
------------------------------------------------
En 1980, l’écrivain américain Russell Banks publie Le Livre de la Jamaïque, à partir d’une série de séjours faits entre 1975 et 1976 sur cette île des Caraïbes au Sud de Cuba. Un récit baigné dans le trouble, l’inquiétude, l’impossibilité de l’acculturation. Un récit qui est tout sauf un recueil de souvenirs ou une invitation au voyage. Un récit de l’impuissance à saisir, à comprendre, dans lequel le vertige de l’étrangeté, entremêlé au désir de l’approche et du partage, produit un sentiment constant de menace. Non la fascination de l’exotisme, mais plutôt ce qui donnera son titre au dernier chapitre, « Terreur ».
Or l’épreuve toute subjective de cette forme de terreur ne réside pas dans telle ou telle scène sanglante, mais bien plutôt dans une configuration sociale et politique dont les données historiques aboutissent à ce constat très simple :
Ce monde était corrompu jusqu’au tréfonds, je le savais, et un crime originel était à la source de cette corruption, un crime connu de tous, des Blancs comme des Noirs, des Jamaïcains comme des étrangers. (…) C’était comme si cette beauté, généreuse et superbe, n’avait d’autre finalité que de cacher quelque honteux secret.
Ce « honteux secret », il lui donne la forme d’un crime qui inaugure l’ouvrage. Mais l’ouvrage n’a rien d’un roman policier. Il ne s’agit pas d’élucider un crime, mais d’éprouver ce dont sa possibilité même suinte de mensonge et de torsion du politique dans le réel contemporain.
1. Une histoire de boucher
Le premier chapitre s’intitule « Capitaine Blood ». C’est le nom d’un film de Michaël Curtiz, sorti en 1935, dont le rôle titre était tenu par Errol Flynn, archétype de l’héroïsme américain, acteur-vedette de Hollywood dont ce film a lancé la carrière. Le narrateur du livre de Russell Banks, livre très documentaire sur le contexte de la Jamaïque, écrit :
Une nuit, très tard, Terron m’a révélé ce qu’il savait d’Errol Flynn.
Terron est le double jamaïcain du narrateur, son interface avec le pays. Errol Flynn (mort en 1959, à l’âge de cinquante ans) a gagné l’île de Navy Island, au large du port de Port-Antonio, au Nord-Est de la Jamaïque, « dans une partie de poker au Princess, un bar-bordel sur le quai », en 1942. Et là, on apprend que les jeunes garçons qui partent à la nage voir ce qui s’y passe sont retrouvés au petit matin, morts dans des filets de pêcheurs.
On apprend aussi une étrange disparition : celle de la femme d’un boucher noir, dont on retrouve dans la mer des morceaux découpés, pris dans des anfractuosités de rochers. Le boucher sera exécuté. Et le récit de son procès est le suivant :
Le boucher De Vries, tout au long de son procès et jusqu’à son exécution, a gardé le silence. Sauf lorsqu’on lui ordonnait de parler : auquel cas il déglutissait, faisait de grands efforts, se contorsionnait et poussait le cri d’oiseau dont Terron a dit qu’il était le fruit de l’œuvre d’Errol Flynn. Car Flynn et son ami le médecin américain Menotti, a déclaré Terron, avaient rendu le boucher muet pour qu’il ne puisse pas témoigner contre eux.
D’Errol Flynn, né en 1909 (plus de soixante-dix ans après l’abolition de l’esclavage), des notices historiques informent comme d’une anecdote qu’il a été trafiquant d’esclaves. Le récit de Terron met en scène, outre Flynn, son ami médecin qui pratique des expérimentations et le fils de ce dernier, qui doit être initié à la sexualité en même temps qu’à la médecine. Flynn demande au boucher jamaïcain de lui fournir une femme comme objet sexuel en échange d’une commission, et celui-ci pense que, s’il fournit sa propre femme, il aura non seulement la commission, mais la rétribution de l’acte. Après livraison, il est appelé dans la nuit pour prendre à son tour livraison, sur une table de cuisine, à sa stupéfaction, du cadavre de sa femme, qu’Errol Flynn lui demande de faire disparaître sans qu’il puisse être identifié. Un jeune rasta, témoin du transport du corps et de sa découpe, sera poursuivi à la machette par Flynn et le médecin auxquels il réussit à échapper. La terreur infligée par Flynn au boucher sera telle qu’elle le rendra muet jusqu’à sa propre exécution, pour un crime dont il n’a pas été l’exécutant.
Ce que cette scène du crime expose, c’est la violence constitutive de rapports de race : prostitution des subalternes indissociable de la brutalité sexuelle, corps noirs marchandisés, vendus, traités, sadisés, tués, découpés comme de la viande. Mais aussi complicité des subalternes dans leur propre réification et dans leur propre extermination. Ce que Russell décrit comme un « monde corrompu jusqu’au tréfonds », parce que la violence génère un système infini de perversion.
Mais le saisissement vient aussi de ce que la figure du criminel raciste et sadique est celle du héros de l’Amérique, de celui qui jouera le rôle de Robin des bois redresseur de torts, de celui qui fascine par sa beauté, son courage, sa puissance et sa séduction. De celui dont les seuls écarts mentionnés sont ceux de l’alcoolisme, témoin, dans la légende hollywoodienne, de résistance physique plutôt que de dégradation.
La quintessence du rêve américain, son éclat lumineux, prend corps dans cette violence nocturne qui démembre les femmes et renvoie à la mer les cadavres des jeunes garçons abusés. Au grand jour, les réceptions, la richesse, la gloire, la beauté, l’admiration et le respect du monde blanc, dont témoignent encore actuellement les films, les photographies, articles et ouvrages sur le sportif accompli, l’aventurier téméraire, l’acteur-star. Dans la nuit, tout ce que savent ceux du monde noir, « un crime connu de tous » … ou plutôt une vie criminelle, vouée à la violence raciste, à l’humiliation et à la perversion, dans la plus totale impunité.
2. La double face du monde
Cette double face du monde, Russell Banks ne cesse de la mettre en évidence dans quasiment tous ses ouvrages, qui traitent tous de ce double langage du monde blanc, de cette tête de Janus de l’Amérique dont les motifs de honte se muent en sujets de gloire. Le boucher vendant, à l’acteur criminel et au médecin expérimentateur, sa propre femme qu’il sera conduit à découper, est rendu muet par la terreur. Il lui a suffi d’entr’apercevoir de quoi sont capables ceux qui lui ont passé commande. Le livre ne dit pas ce qu’il a vu sur le corps qu’il découpe, ni sur la tête et le visage qu’il va faire disparaître. Mais cet homme de sac et de corde, décrit lui-même comme violent et capable de calculer le parti qu’il pourra tirer de la prostitution de sa compagne, est suffisamment tétanisé par la violence dont il est témoin, à la fois complice et menacé, pour ne pouvoir articuler que des cris d’oiseau lors de son procès. Il est noir, et cela suffit pour l’exposer à de tels abus que l’exécution leur est au final préférable. C’est de cela qu’il est question : non pas des perversions d’un criminel, mais de l’impunité absolue du monde blanc face au monde noir. Et des clivages que cela génère au sein des deux mondes.
Car cette double face est aussi terrorisante qu’elle est intrinsèquement clivante. Russell Banks en montre les effets sur le peuple de la Jamaïque, en quasi-totalité noir, divisé par l’histoire même de l’esclavage :
C’est l’écart entre ceux qui considéraient le peuple marron comme un État à part en Jamaïque et ceux qui souhaitaient s’accommoder de l’entité nationale plus vaste et s’y assimiler. C’était la division entre ceux qui s’estimaient africains et ceux qui se voyaient comme des anciens esclaves, (…) entre les révoltés qui jugeaient leur rébellion (de même qu’auparavant leur esclavage) comme déterminée par la race, et les chasseurs de prime qui, à la suite du traité, avaient traqué avec ardeur les esclaves fugitifs que ni les soldats anglais ni les planteurs n’arrivaient à débusquer dans la jungle.
M. Mann, celui qui initie le narrateur, dans sa langue créole, à l’histoire de la Jamaïque, lui raconte comment Christophe Colomb y débarque en échappant à une mutinerie sur son propre navire. De fait, la Jamaïque sera d’abord le domaine privé de la famille de Colomb. Et les Indiens Arawak qui la peuplent, réduits en esclavage productif et sexuel, seront ainsi livrés à l’extermination, puisqu’il n’en reste plus aucun à la fin du XVIème siècle. Au XVIIème siècle, l’île passera aux mains des Anglais, et fera l’objet d’un étrange accord entre la couronne d’Angleterre et les protestants français chassés par la monarchie absolue lors de la révocation de l’Édit de Nantes. Ce sera du reste l’objet du « Code Noir », élaboré par Colbert et édicté par Louis XIV en 1685 dans les Caraïbes françaises, d’y règlementer l’esclavage à seule fin que les Protestants ne puissent pas en profiter, donnant ainsi une teneur prioritairement religieuse à un texte qui légitime les exactions raciales de masse. Car la Jamaïque anglaise, qui accueille les opposants français, est une plaque tournante de la Traite des Noirs.
Au XVIIIème siècle, les 300 000 esclaves que compte l’île constituent l’immense majorité de sa population. Les révoltes sont alors récurrentes, et les esclaves en fuite constituent les formes de socialisation parallèles du « marronnage » , se réappropriant une terminologie qui les désigne par l’appellation discréditante de « cimarron » : porc revenu à l’état sauvage. Les « nègres marrons » sont donc perçus non pas comme des hommes qui retrouvent leur condition d’hommes, mais comme des animaux élevés à la domesticité, puis dégradés par leur propre indiscipline, et renvoyés dès lors à leur sauvagerie originelle. Les chasses à l’homme ne peuvent alors se faire par les seules forces des Blancs ultra-minoritaires, elles vont nécessiter la complicité active des esclaves restés asservis, utilisés comme des chiens de chasse au service de leurs maîtres : les chasseurs de prime qui, à la suite du traité, avaient traqué avec ardeur les esclaves fugitifs que ni les soldats anglais ni les planteurs n’arrivaient à débusquer dans la jungle.
Lorsqu’un Traité sera signé entre le gouvernement britannique et les Marrons constitués en société – celui de 1738, anticipant sur l’indépendance accordée à un pays qu’il est devenu impossible de tenir entièrement sous la férule –, le pacte se fait dans des termes plus pervers encore, qu’Alejo Carpentier désignera dans Le Siècle des Lumières :
Ils signent en 1738 un traité de paix avec les autorités britanniques, en contre-partie duquel ils s’engagent à leur livrer tout nouvel esclave fugitif et à les aider à mater les révoltes.
C’est ce clivage au sein du peuple jamaïcain, entre l’État Marron et les futurs fugitifs qu’il livrera aux Anglais, qui va se répercuter et doubler le clivage originel entre Noirs et Blancs. Banks le présente ainsi :
La moitié des Marrons croyaient que leurs relations avec le gouvernement de la Jamaïque – depuis l’Indépendance comme au temps de la domination britannique – étaient définies par le Traité de 1738-1739 ; les autres ne pensaient strictement qu’en termes de pouvoir et espéraient surtout préserver le statut qui les exemptait d’impôts, en échange de quoi ils étaient prêts à faire à peu près tout ce que le gouvernement leur demandait.
La population noire va ainsi intégrer en son sein la division entre ceux qui s’estimaient africains et ceux qui se voyaient comme des anciens esclaves. Et l’esprit « rasta », renvoyé vers la culture éthiopienne, incarne actuellement encore le premier terme de cette division. Une histoire de la violence externe, répercutée en violence interne, va ainsi imprégner en profondeur le devenir de la Jamaïque.
3. La faiblesse du dominant
Ce que montre Russell Banks, c’est que la profondeur de cette histoire, ses racines en-deçà même du commerce triangulaire, sont inaccessibles au Blanc présent sur le territoire. Le narrateur désire ardemment savoir, mais il doit faire muter sa volonté d’enquête en une sorte de quête initiatique, qu’il n’arrive pas même à mener à bien, mais dont il ne sortira cependant pas indemne. Quarante ans plus tard, publiant Voyages en 2016, Banks, quittant le masque du narrateur pour se nommer, reviendra sur cette période de sa vie, où l’opacité du pays aura contribué à opacifier sa propre vie privée jusqu’à la faire imploser. Violence des rapports de race, violence des rapports de classe, violence des rapports de sexe, violence des collusions et des trahisons, ont construit une histoire chaotique, menée par sa propre logique, dont la langue même du récit échappe à celui qui veut la saisir.
Tout au long du Livre de la Jamaïque, le narrateur américain blanc, que tout le monde finit par appeler « Johnny », de ce nom générique qui ne désigne qu’un archétype de western, sera confronté à cette difficulté avec la langue. Pas simplement avec le vocabulaire ou les tournures syntaxiques, mais avec la forme de l’imaginaire, la profusion des analogies, les ellipses, la richesse télescopée des métaphores, qui ne constituent pas seulement une langue, mais une forme de pensée et un rapport à la transmission. L’anglais créole de la Jamaïque, plus élégant, plus riche, plus complexe, fait paraître, par contraste, à ce voyageur américain, son propre anglais grossier, épais et quasiment vulgaire. Les sonorités brutales de la langue américaine y sont confrontées au parler musical d’un pur anglais des origines, réinterprété, à la fois originel et monté en raffinement. L’équivalent du français créole d’Édouard Glissant.
Toute une intelligence des lieux, des traditions, des circulations, des espaces, des alliances et des antagonismes, toute une perception des sons, toute une épreuve des atmosphères, tout un rapport au rythme, au mouvement, à la danse, à la parole, échappe de part en part à celui qui refuse d’être un touriste et ne parvient pourtant jamais à devenir autre chose qu’un Blanc ; à celui qui voudrait être un allié et ne saisit toujours que maladroitement la réalité des affiliations et la profondeur des antagonismes ; à celui pour lequel les sons ne font pas signe, et qui pour cette raison même a peur parce qu’il ne sait jamais ce qu’il doit craindre. À celui pour lequel la beauté des paysages signifie d’abord leur inaccessibilité, mais aussi le danger de l’inintelligible.
Un monde réputé subalterne s’offre ainsi au narrateur comme dominant, imposant, par l’histoire des violences qu’il a subies, celle des violences qui l’ont construit et le rendent inaccessible à ses propres dominateurs. La langue, la musique, l’érudition historique, l’archive des traités, la complexité des acculturations religieuses, font de ce monde un monde opaque à l’occupant autant qu’à l’arrivant. Un monde en quelque sorte de la guérilla permanente, dans lequel la tactique est celle de la dissimulation, où l’embroussaillage est la condition de la survie : l’espace vivifiant et terrifiant du marronnage.
4. Le creuset de la Jamaïque
La force du livre de Russell Banks est qu’il met précisément au jour cette faiblesse : l’infériorité constitutive de toute culture hégémonique face à la complexité des cultures dominées, construites et patiemment élaborées par les strates de l’affrontement à cette domination. Et cette épreuve de la faiblesse est la matière du travail de l’auteur, parce qu’elle structure la figure du narrateur. En brisant les rapports de fiabilité, elle l’oblige pourtant à faire confiance, à l’aveugle. La formule qui revient tout au long du livre est celle par laquelle son mentor jamaïcain l’encourage à persister dans sa quête : Vous verrez ce que vous voulez voir. Accentuée sur le premier verbe, elle est le présage d’un succès. Mais accentuée sur le second, elle devient, réinterprétée dans la bouche de son propre double noir, compagnon de route et soutien, la désignation sceptique d’une incertitude et le signe d’un échec :
Vous verrez ce que vous voulez voir. Je ne cessais de me souvenir de ces paroles que M. Mann m’avait adressées en février quand j’avais quitté Nyamkopong pour revenir à Anchovy, puis aux Etats-Unis. Jamais Terron ne m’avait rien dit d’aussi menaçant.
Le livre entier et construit sur ce doute, sur l’ambivalence de cette formule dont le narrateur ne sort pas : ce qu’il voit n’est rien d’autre que ce qu’il est capable d’anticiper, et la perception n’enfonce aucune autre porte que celles qui sont déjà ouvertes. Cette perception, soumise au déterminisme culturel, est préconstruite pour ne rien pouvoir découvrir. Et c’est là le sens ultime de ce que le narrateur éprouve comme « menaçant ». Car la menace est double : risque de ne pouvoir jamais savoir, et dangers auxquels expose cette impuissance, par l’aveuglement qu’elle génère.
De ce déterminisme, il ne peut envisager de se libérer que par des tentatives initiatiques qui, au final, demeureront avortées : le Blanc entre deux mondes, même dégoûté par ses propres origines, est inapte à se reconfigurer et demeure toujours, dans ses tentatives d’acculturation, handicapé.
Le Livre de la Jamaïque, publié en 1980, anticipe sur ce que seront Cloudsplitter en 1998, puis The Darling en 2004 : trois angles d’attaque différents de la question raciale. Le premier opère à partir de la terre originelle sur laquelle se fonde la violence coloniale sur le continent américain : l’archipel des Caraïbes, premier accostage de Christophe Colomb à la fin du XVème siècle, premier lieu d’extermination des Indiens au XVIème et plaque tournante de la Traite des Noirs au XVIIème. Le second, Cloudsplitter, opère à partir du territoire nord-américain, autour de la figure de John Brown, abolitionniste passé à la lutte armée, et des conflits autour de l’esclavage qui donneront lieu à la Guerre de Sécession. Le troisième, The Darling, opère à partir du Libéria, terre colonisée au XIXème siècle par les anciens esclaves américains produisant de nouvelles formes de domination politique sur le continent africain.
La Jamaïque est donc véritablement un creuset, dans lequel s’élabore l’œuvre de Russell Banks autour de la double question du rapport aux subalternes et du rapport à la race. Ce creuset est celui du double langage de l’Amérique, mis en évidence par l’auteur dans un entretien de 2010 :
En 1787, la Constitution Américaine s'est construite sur une violente contradiction : d’un côté la défense des droits de l’homme, mais, de l'autre, un préambule qui acceptait l’institution de l’esclavage. C’est cette contradiction qui a entraîné notre guerre la plus sanglante et poussé le pays au bord de l’explosion. Nous sommes encore en train d’essayer de la résoudre. C’est cette même contradiction qui se cachait derrière l’institutionnalisation du racisme.
La question raciale, générée dans le creuset de la Jamaïque, fait de l’Amérique un espace de violence larvée, occulte et corruptrice, à l’image de la vie vulgairement criminelle et destructrice de l’acteur qui a servi de vitrine à la production de son mythe hollywoodien, et nourri ainsi l’imaginaire glorieux qui masquait la réalité sordide de sa domination.
Ce que le livre fait surgir, c’est le véritable feuilletage culturel qui s’est opéré dans ce creuset, de la côte livrée à l’organisation économique de la prédation, à l’intérieur des terres propice à la fuite et au marronnage. Une infime minorité blanche étend son système d’exploitation à une immense majorité noire par un système de terreur, mais les processus d’échappement sont si nombreux qu’ils ne peuvent permettre aucune hégémonie absolue. Une culture de l’occultation, multiple, diversifiée, contradictoire, naît de ces nécessités de la survie et invente d’autres formes de langage et de savoir, plus riches, plus complexes, plus inquiétantes. À la fois issues des subjectivités dominées et définitivement menaçantes.
L’industrie touristique elle-même qui, comme le dit Banks, « corrompt et ronge l’intégrité et l’indépendance des peuples », est aussi de fait incluse dans ce processus d’occultation par lequel l’obscénité de l’exotisme recouvre la réalité énigmatique des profondeurs. À cette obscénité-là, le narrateur oppose l’intuition existentielle d’un rapport de double, où les jeux de pouvoir ignorés construisent la mise en miroir d’un abîme :
Tu reviens à tout cela, à cette île sanglante, sombre et splendide, de la Jamaïque qui est l’envers presque parfait de ton monde.
Tenter d’approcher cet envers, c’est produire le revers de son propre monde ; mais c’est y ouvrir aussi le possible de ses contestations.
BIBLIOGRAPHIE
BANKS R., Le Livre de la Jamaïque, 10/18, Arles, Actes Sud, 1991.
BANKS R., Le Pourfendeur de nuages, Arles, Actes Sud, 1999.
BANKS R., American Darling, Arles, Actes Sud, 2005.
GLISSANT É, Tout-monde, Paris, Gallimard, 1993.
TOUAM BONA D., Fugitif, où cours-tu ? , Paris, PUF, 2016.
CARPENTIER A., Le Siècle des Lumières, Paris, Gallimard Folio, 1977.
FANON F., Œuvres, Paris, La Découverte, 2011.
THOMAS H., La Traite des Noirs, Paris, Laffont, 2006.
ARENDT H., L’Impérialisme, Paris, Points Seuil, Gallimard, 2002.